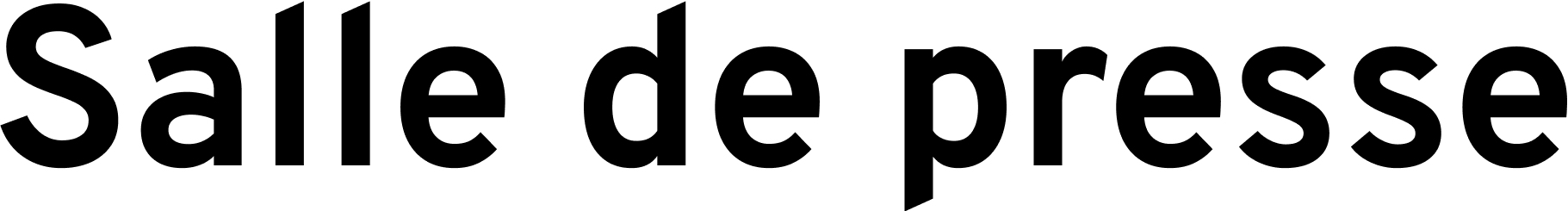Voici quelques interventions de la communauté au cours de la semaine du 1er mai.
- Malgré un bilan financier à l’encre rouge, Aéroports de Montréal (ADM) a remis 3,8 millions en primes en 2021. Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l’Université Laval, souligne qu’il semble y avoir un processus bien défini pour gérer ces primes. Cela dit, cela serait intéressant d’avoir des informations plus granulaires sur ce que constituent les indicateurs.
Environ 3,8 millions en primes malgré les restrictions sanitaires (La Presse) - Au Québec comme au Canada, les femmes font jusqu’à deux fois moins de sport que les hommes. Cette différence est observable dès la petite enfance. Selon Guylaine Demers, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université Laval, on doit réunir plus de femmes autour des tables de décision pour défendre leurs enjeux et permettre aux plus jeunes d’avoir des modèles.
Les femmes font moins de sport que les hommes, pourquoi ? (Châtelaine) - La science en français recule et cela, même dans les universités canadiennes où l’on parle français. La diplomatie scientifique en français gagne cependant du terrain, selon Mathieu Ouimet, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Ce jeune concept, qui explore les relations entre la science et la technologie, et les affaires internationales.
La Francophonie scientifique au temps des alliances (Agence Science-Presse) - Les chercheurs canadiens et étrangers publient dans des revues scientifiques canadiennes gérées par une agence fédérale. Serge Payette, professeur associé à la Faculté des sciences et de génie, de l’Universté Laval, rappelle que ces revues de qualité sont officiellement bilingues, ce qui signifie que les chercheurs peuvent y publier des articles écrits en français, dans un texte d’opinion.
Le français en sciences recule au Canada (Le Devoir) - Alors que le gouvernement est enlisé dans l’enjeu de l’ingérence chinoise, des libéraux espèrent que Justin Trudeau profitera de son passage au congrès du PLC à Ottawa pour rallumer la flamme des militants. Selon Éric Montigny, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, Justin Trudeau ne doit pas rater l’occasion qui lui est offerte.
Des libéraux fédéraux cherchent le « buzz » au congrès du parti (Radio-Canada) - Pertes d’emplois, isolement, tâches qui s’accumulent : la pandémie a durement touché les femmes. Marie-Claude Beaulieu, professeure à la Faculté des sciences de l'administration de l’Université Laval, constate que certaines femmes en finance, particulièrement les mères, se sont désengagées de leur travail au cours de la pandémie, souvent en raison de la lourdeur de la tâche.
À la recherche de la recette magique (La Presse) - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, affirme que les coupes forestières effectuées et planifiées dans le secteur du réservoir Pipmuacan étaient inévitables. Selon Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, le MRFN aurait très bien pu ne pas renouveler les permis de coupe annuels.
La ministre des Forêts contredite par son ministère (La Presse) - Le revirement de situation dans le dossier du troisième lien démontre que le gouvernement Legault n’a probablement pas suivi les bonnes pratiques en matière de gestion de projet. Selon Pierre-André Hudon, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l’Université Laval, dans le cas précis du troisième lien, le poids de la promesse électorale a peut-être pesé trop lourd.
Faut-il dépolitiser la gestion des grands projets de transport? (Radio-Canada) - Des outils ont été mis en place pour aider les communautés locales à faire entendre leurs voix face aux sociétés minières, mais le rapport de force demeure en faveur de l’industrie. Selon Thierry Rodon, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, les communautés autochtones, bien qu’elles connaissent mieux leurs droits, ne sont pas épargnées par cette réalité.
Les inégalités se creusent dans les régions minières, selon des experts (Le Devoir) - Les enseignants québécois sont-ils au bout du rouleau ? Chose certaine, ils en ont lourd sur les épaules et il faut mieux en prendre soin. Simon Viviers, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université Laval, dit observer de la souffrance et du mal-être chez un nombre appréciable d’enseignants. Selon lui, il manque de mécanismes de prévention.
Nos profs au bord de la crise de nerfs ? (Journal de Québec) - Avec la fonte du pergélisol, une nouvelle étude démontre que des contaminants toxiques de toutes sortes, accumulés depuis des décennies sur des sites industriels dans le Grand Nord, sont à risque de s’échapper. Tabatha Raman, doctorante à l’Université Laval, explique ce qui pointe à l’horizon d’un dégel, le pergélisol canadien étant composé de terre, de roche et de beaucoup de glace.
La fonte du pergélisol ouvre la porte à une dispersion massive de contaminants (La Presse canadienne via La Presse) - Au Québec, à quel point sommes-nous prêts à accepter des personnes transgenres dans nos publicités? D’après Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l’Université Laval, le choix d’un partenariat avec une personne transgenre est un signe d’ouverture, qui peut élargir la clientèle. Selon lui, il est temps que les efforts marketing reflètent la diversité.
Sommes-nous prêts à accepter des transgenres dans nos publicités? (Journal de Québec) - La pandémie a transformé le visage du monde du travail partout sur le globe, façonnant au passage les défis au sein des mouvements syndicaux. Pour Simon Coulombe, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, favoriser un climat de sécurité psychosociale est donc un facteur de protection pour toute société qui choisit de le placer au cœur de ses priorités.
Des mobilisations à l'étranger qui résonnent (Le Devoir)