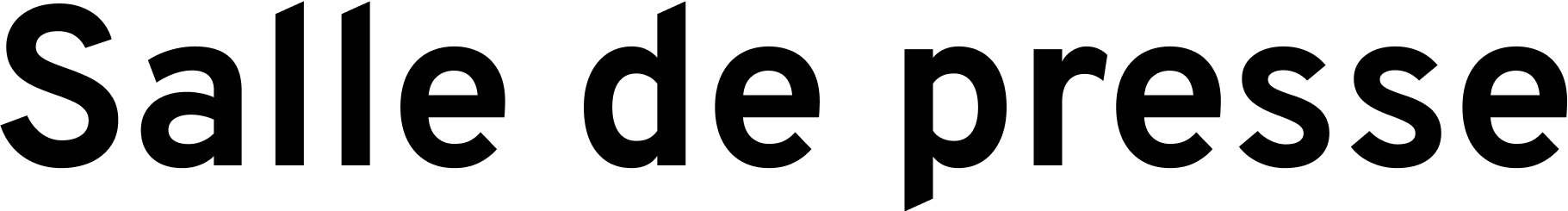12 février 2025
Les fonds des lacs sont de véritables archives environnementales – leur étude en dit long sur l’histoire d’un lieu
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

Nous devons nous pencher sur l’impact des changements climatiques et de l’activité humaine sur nos lacs.
— Shutterstock
Un texte cosigné par Dermot Antoniades, professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, et le chercheur Hamid Ghanbari, diplômé du doctorat.
Le Canada compte plus de lacs que tout autre pays au monde, et ceux-ci présentent une grande diversité de tailles, de profondeurs, de formes, de propriétés chimiques ainsi que de caractéristiques géologiques et hydrographiques (les eaux qui affluent dans les lacs et en sortent). Les sédiments s’accumulent dans les fonds qui, loin des rives et à des profondeurs non perturbées, jouent le rôle d’archives.
Lorsqu’une étendue d’eau connaît une prolifération d’algues, une absence de poissons ou de grandes quantités de mauvaises herbes, il est difficile de déterminer si cela fait partie de son cycle naturel ou si ce sont les résultats de l’activité humaine. Pour cela, il faut comprendre l’histoire du lac, notamment son état avant que les humains ne s’installent dans la région.
Cet article fait partie de notre série Nos lacs : leurs secrets, leurs défis. Cet été, La Conversation vous propose une baignade fascinante dans nos lacs. Armés de leurs loupes, microscopes ou lunettes de plongée, nos scientifiques se penchent sur leur biodiversité, les processus qui s’y produisent et les enjeux auxquels ils font face. Ne manquez pas nos articles sur ces plans d’eau d’une richesse inouïe !
En tant que chercheurs en paléolimnologie, science qui s’intéresse à l’histoire des sédiments d’eau douce, nous analysons les sédiments déposés au fond des lacs. Cette accumulation de matières organiques et inorganiques provenant de l’intérieur et de l’extérieur de l’écosystème nous aide à connaître l’histoire d’un lac et son évolution au fil du temps.
Voir à travers des parois de verre
Les diatomées sont un groupe de microbes qui se conservent très bien dans les sédiments lacustres. Ces algues unicellulaires ont des parois cellulaires délicatement ornées, dont une morphologie distincte caractérise chaque espèce. Comme ces parois sont constituées de silice opaline, essentiellement du verre, elles sont préservées dans les sédiments même après la dégradation de leurs composants organiques.

La forme des parois cellulaires des diatomées reflète souvent leur habitat dans le lac, et ce, qu’elles flottent en eaux libres (espèces planctoniques) ou qu’elles vivent plus près du rivage ou au fond du lac, fixées à des rochers, à des sédiments ou à de la végétation (espèces benthiques). En outre, différentes espèces sont adaptées à différents milieux, par exemple à des concentrations élevées ou faibles de nutriments, à divers niveaux de salinité ou d’acidité. Nous pouvons ainsi utiliser les restes de diatomées dans les sédiments pour reconstituer les environnements lacustres passés.
Malheureusement, ce n’est pas tout ce qui vit dans les lacs qui se conserve, et une grande partie du matériel cellulaire des microbes photosynthétiques se décompose avec le temps. Le principal pigment photosynthétique est la chlorophylle a, qui se dégrade progressivement. Toutefois, les molécules issues de sa décomposition sont plus stables.
En mesurant la chlorophylle a et ses produits de dégradation dans les sédiments, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de la production primaire d’un lac (la quantité de biomasse photosynthétique) au fil du temps. Pour y arriver, on analyse par spectroscopie la façon dont les sédiments absorbent et réfléchissent la lumière, car la chlorophylle a et ses produits de dégradation absorbent la lumière dans des longueurs d’onde précises.
En étudiant l’évolution des espèces de diatomées et la chlorophylle a sédimentaire à partir de différents intervalles de carottes, nous pouvons déduire comment les « producteurs » à la base du réseau alimentaire du lac ont changé au cours des siècles, voire des millénaires.
Les lacs canadiens en transformation
Notre équipe a examiné les diatomées et la chlorophylle a sédimentaire de plus de 200 lacs au Canada dans le cadre de LakePulse, un programme d’échantillonnage à grande échelle.

Dans chaque lac, nous avons prélevé une carotte de sédiments et analysé des échantillons de la partie supérieure et de la partie inférieure de la boue. Cela représentait des échantillons modernes (déposés au cours des dernières années) et préindustriels (déposés il y a plus de 150 ans, avant le développement de pratiques industrialisées). En comparant les diatomées modernes et préindustrielles dans chaque lac, nous avons trouvé deux modèles clairs résultant des impacts du développement humain et du réchauffement climatique.
La première tendance constatée est que les lacs entourés de fortes concentrations d’exploitations agricoles ou de zones urbaines avaient connu les changements les plus importants. La composition des espèces de diatomées a évolué vers des formes mieux adaptées à une hausse des nutriments et de la salinité. Les changements les plus marqués se sont produits dans les Prairies, où l’on observe un développement agricole intense et des lacs relativement peu profonds, plus sensibles à la pollution par les nutriments.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
La deuxième tendance est une augmentation générale des diatomées planctoniques. L’été, de nombreux lacs connaissent un phénomène appelé stratification thermique, où les eaux supérieures sont chauffées par le soleil et reposent sur des eaux plus froides. Avec le réchauffement climatique, la période de stratification des lacs s’est allongée.
Des recherches antérieures nous ont appris que les diatomées planctoniques se développent particulièrement dans des milieux à stratification thermique et en eau libre. Les chercheurs de LakePulse ont constaté une augmentation des diatomées planctoniques dans la majorité des lacs canadiens, peu importe le niveau d’activité humaine, ce qui indique que les changements climatiques ont un effet marqué sur la composition de ces producteurs primaires.
La chlorophylle a sédimentaire a également révélé une hausse de la production primaire dans la majorité des lacs canadiens, ce qui reflète l’allongement des périodes d’eau libre (où la plupart des lacs atteignent leur production maximale) à mesure que diminue la durée de la couverture de glace sous l’effet des changements climatiques.

Protection des lacs
Partout au Canada, les changements climatiques et les activités humaines affectent les producteurs primaires dans les réseaux alimentaires des lacs. Les conditions physiques changent également, avec des périodes de stratification plus marquées et plus longues dans de nombreux lacs, et des niveaux accrus de nutriments et de salinité dans ceux où l’incidence humaine est importante.
Ces changements peuvent avoir de graves conséquences. La hausse de la production d’algues donne lieu à une situation où la décomposition des organismes qui meurent et se déposent au fond du lac engendre une consommation de l’oxygène des eaux de fond. Des périodes de stratification plus longues peuvent aussi entraîner un appauvrissement en oxygène, car le délai entre les épisodes de mélange qui renouvellent l’oxygène dans les eaux froides du fond s’allonge.
Ce phénomène peut avoir des effets dévastateurs sur les espèces d’eau froide, telles que la truite grise, qui ont besoin d’une eau froide à forte teneur en oxygène pour survivre pendant les mois d’été.
En comprenant mieux l’évolution des écosystèmes au fil du temps grâce à la paléolimnologie, nous obtenons des informations précieuses sur les impacts de l’activité humaine et des changements climatiques sur les lacs canadiens. Ces connaissances permettront de préserver la santé de nos ressources en eau douce pour les générations futures.
Katherine Griffiths du Collège Champlain de Saint-Lambert a co-rédigé cet article.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.