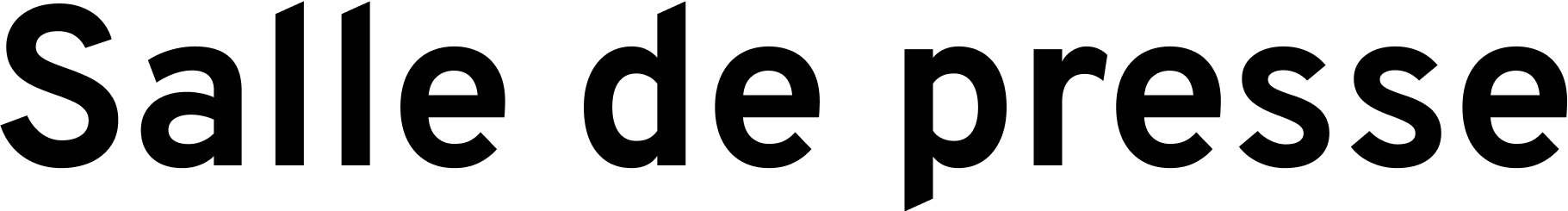3 juillet 2025
Les fondations philanthropiques doivent-elles mourir pour mieux agir?
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

Bill Gates annonçait récemment qu'il comptait épuiser le fonds de dotation de la Fondation Bill & Melinda Gates d’ici 2045.
— AP Photo/Manish Swarup
Un texte cosigné par Sacha-Emmanuel Mossu, étudiant au doctorat à la Faculté de philosophie.
Le modèle traditionnel de la philanthropie repose sur l’idée que les fondations doivent durer éternellement, en préservant leur capital et en redistribuant chaque année une petite partie de leurs revenus. Pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent pour remettre en question cette logique, parfois jugée lente, inefficace et déconnectée de l’urgence des besoins sociaux. Et certains philanthropes commencent à montrer l’exemple.
En mai, le milliardaire Bill Gates a annoncé qu’il comptait épuiser le fonds de dotation de la Fondation Bill & Melinda Gates d’ici 2045. Cela représentera des investissements philanthropiques de plus de 200 milliards de dollars américains ainsi que la fermeture, à terme, de l’organisation. Cette annonce rompt avec les normes de la philanthropie partout dans le monde, où les fondations sont généralement conçues pour durer indéfiniment.
Le Canada n’y fait pas exception. En s’enregistrant auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), les fondations peuvent faire fructifier leurs actifs tout en générant des revenus exempts d’impôts. Même si la loi les oblige à dépenser chaque année un minimum de 5 % de leurs actifs, les rendements réalisés sur les marchés financiers égalent ou dépassent souvent ce seuil. Les fondations peuvent donc se contenter de distribuer année après année les intérêts de leurs investissements, sans jamais toucher au capital.
Ce modèle « de charité à perpétuité » se fait souvent reprocher son inefficience fiscale. Selon la fiscaliste Brigitte Alepin, il faut en moyenne 35 ans pour que les activités caritatives d’une fondation compensent les avantages fiscaux perçus par ses fondateurs.
Je suis doctorant en philosophie à l’Université Laval en cotutelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et mon collègue David Grant-Poitras est doctorant en sociologie à l’Université du Québec à Montréal. Affiliés au Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab), basé à l’Université du Québec à Montréal, nous étudions la philanthropie dans le cadre de nos travaux de recherche. Nous travaillons à documenter le processus de fermeture de la Ivey Foundation, qui co-finance la recherche.
Un modèle alternatif qui fait ses premiers pas au Canada
Bien que la perpétuité fasse office de norme dans le milieu philanthropique, certaines fondations remettent en question sa pertinence. À côté des fondations dites « pérennes », un nouveau modèle prend forme : les fondations à durée de vie limitée (ou sunsetting foundations en anglais). Celles-ci s’engagent délibérément à dépenser l’entièreté de leurs actifs et cesser leurs activités au terme d’une période donnée ou suivant l’atteinte d’objectifs spécifiques.
Ce modèle n’est pas nouveau : il a été mis en œuvre par des pionniers comme le Rosenwald Fund, la Aaron Diamond Foundation ou encore la John M. Olin Foundation, fermés respectivement en 1948, 1996 et 2005. Toutefois, il connaît un regain d’intérêt, particulièrement aux États-Unis, où un nombre croissant de fondations, surtout les plus jeunes, adoptent cette approche. Même si la pratique reste marginale au Canada, certaines fondations comme la Ivey Foundation, dont la fermeture est planifiée pour 2027, commencent à suivre le mouvement.
Moins de temps, plus d’impact !
Pourquoi choisir de fermer une fondation plutôt que de lui assurer une existence perpétuelle ? Pourquoi des philanthropes comme Bill Gates ne préfèrent-ils pas assurer la survie d’une institution qui immortalisera son nom ? Dans un cahier de recherche publié récemment, le Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie s’est penché sur la question.
Plusieurs raisons peuvent motiver un tel choix : décès des fondateurs, conflits familiaux, ou encore volonté de constater de son vivant les effets de sa philanthropie. Mais au-delà de ces facteurs, c’est souvent un souci d’efficacité qui pousse ces fondations à limiter leur durée de vie.
À ce sujet, la sociologue Francie Ostrower, professeure à la LBJ School of Public Affairs and College of Fine Arts de l’université du Texas à Austin, suggère que les fondations « pérennes » ont parfois tendance à faire de leur propre survie un objectif, au détriment de leur mission sociale. À l’inverse, les fondations à durée limitée se perçoivent davantage comme des « véhicules » au service des causes sociales qu’elles soutiennent. Dans cette optique, rejeter la perpétuité devient une stratégie pour maximiser l’impact social.
Programmer sa fermeture donne souvent aux fondations plus de flexibilité et de marge de manœuvre. Cela permet, par exemple, d’augmenter les dépenses annuelles bien au-delà du seuil de 5 %, et donc de soutenir davantage d’organismes ou de financer des projets ambitieux nécessitant des investissements massifs à court terme. Dans certains cas, l’abandon de la perpétuité réduit les dépenses administratives, ce qui dégage des ressources à réinvestir dans ce qui compte vraiment.
De plus, puisque la gestion des dépenses est affranchie des contraintes liées à la pérennisation du fonds de dotation, les fondations à durée de vie limitée s’adaptent plus facilement aux événements imprévus et sont plus réactives à l’évolution des besoins sur le terrain.
Ce modèle est d’autant plus attrayant pour les petites et moyennes fondations qui peuvent ainsi accroître considérablement leur influence dans leur secteur, chose difficile dans un modèle fondé sur la préservation du capital.
Ne pas juste donner plus, mais donner mieux
Notre recherche montre également que les avantages ne sont pas seulement d’ordre quantitatif ou financier, mais aussi qualitatif. Planifier sa fermeture pousse aussi à réfléchir en profondeur à l’utilisation optimale des ressources disponibles dans un laps de temps limité. D’après plusieurs témoignages, l’échéance imposée par la fermeture motive le personnel de la fondation, génère un sentiment d’urgence et instaure une meilleure discipline. Cela incite à concentrer efforts et ressources sur les projets essentiels et à éviter le gaspillage sur des activités jugées secondaires.
Paradoxalement, limiter la durée de vie d’une fondation ne signifie pas adopter une vision à court terme. Au contraire, tout indique que cela favorise une réflexion sérieuse sur la durabilité et les impacts à long terme des projets financés.
Sachant qu’elles ne seront pas là pour toujours, les fondations à durée de vie limitée sont naturellement portées à trouver des solutions pérennes aux problèmes sociaux et à renforcer les capacités des organisations qui prendront le relais une fois qu’elles auront cessé leurs activités. Bref, comme l’affirme le philanthrope américain Jack Eckerd, « si les fondations sont éternelles, elles mettront une éternité à accomplir quoi que ce soit ».
Alors que 135 milliards dorment dans les fonds de dotation des fondations canadiennes, le moment est peut-être venu de repenser le modèle dominant. En encourageant le développement de fondations à durée de vie limitée, le Canada pourrait non seulement réinjecter massivement des ressources dans la société, mais aussi revitaliser le rôle du secteur philanthropique dans la réponse aux enjeux sociaux les plus pressants.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.