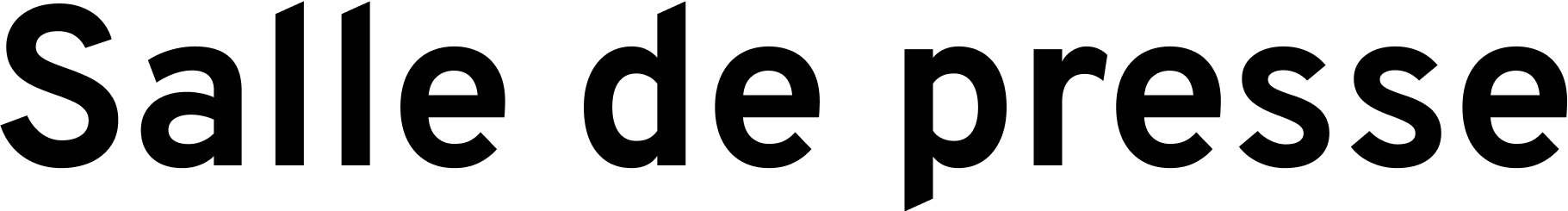2 juillet 2025
Une avancée québécoise dans le traitement de la schizophrénie
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

La recherche en santé mentale exige aujourd’hui des ressources spécialisées, des bases de données robustes, des infrastructures de pointe et des expertises diversifiées.
— Shutterstock
Un texte cosigné par Nicola Thibault, étudiant au doctorat à l'École de psychologie.
La schizophrénie figure parmi les maladies mentales les plus stigmatisées et les plus incommodantes.
Bien que certains de ses symptômes, dits « positifs » – tels que les hallucinations ou les idées délirantes – soient bien connus du grand public, d’autres restent dans l’ombre. Et ce, souvent tant pour l’équipe soignante que pour l’entourage de la personne.
Ces symptômes sont qualifiés de « négatifs », puisqu’ils sous-tendent une diminution des fonctions psychologiques normales. On peut par exemple penser à la perte de motivation, une grande fatigabilité, une difficulté à ressentir ou à exprimer des émotions, ainsi qu’un retrait social important.
Ce sont souvent ces symptômes qui contribuent au maintien de la souffrance à long terme chez les patients atteints de schizophrénie et à leur isolement.
À ce jour, les traitements disponibles ciblent davantage les symptômes positifs que négatifs. Les approches pharmacologiques, bien qu’efficaces sur les symptômes positifs, demeurent limitées lorsqu’il faut agir sur les symptômes négatifs.
Dans ce contexte, la recherche en santé mentale est confrontée à un défi de taille : trouver des interventions novatrices qui agissent là où les approches traditionnelles échouent.
Traiter la schizophrénie, autrement
C’est précisément l’ambition d’un projet de recherche dirigé par le Dr David Benrimoh et le Dr Lena Palaniyappan, chercheurs au centre de recherche Douglas. Leur équipe s’intéresse à une piste prometteuse : la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, mieux connue sous le nom de rTMS.
Déjà utilisée et réputée comme traitement pour la dépression, la rTMS est une forme de neuromodulation, dite non invasive. Autrement dit, cette technique agit sur l’activité de certaines zones du cerveau en utilisant un champ magnétique puissant pour créer un courant dans les neurones, le tout sans avoir besoin de chirurgie ni de procédure douloureuse.
Elle consiste à appliquer des impulsions magnétiques sur des régions prédéfinies du cerveau à l’aide d’un appareil posé sur le cuir chevelu. Ce champ magnétique induit un courant de faible intensité qui module l’activité des neurones de la région ciblée.
Dans le cas de la dépression, où les symptômes négatifs sont au premier plan, plusieurs études ont montré que ce traitement pouvait contribuer à améliorer l’humeur, l’énergie et la motivation des patients.
Or, son application sur les symptômes négatifs dans la schizophrénie apporte son lot de défis et demeure une technique émergente.
Un protocole accéléré et personnalisé
À ce jour, la littérature scientifique montre des effets modestes de la rTMS sur les symptômes négatifs de la schizophrénie.
De plus, l’administration de la rTMS sur une période de plusieurs semaines pose de nombreux obstacles techniques pour les patients. Notamment, ces derniers doivent se déplacer plusieurs fois par semaine afin d’obtenir leur traitement, ce qui peut avoir des impacts importants sur la vie de ces derniers. Sans oublier qu’il peut être difficile pour les individus souffrant d’une diminution de la motivation et d’un manque d’énergie, soit les symptômes négatifs, de se déplacer jusqu’au centre où ils reçoivent leur traitement. Ces défis peuvent mener à l’abandon du traitement de la rTMS.
L’étude du Dr Benrimoh et du Dr Palaniyappan propose donc deux innovations majeures : (1) réduire la durée du traitement à cinq jours seulement et (2) optimiser la précision du traitement en utilisant l’imagerie cérébrale afin de mieux cibler les régions du cerveau impliquées dans la motivation et l’émotion.
Ce protocole accéléré et personnalisé de la rTMS sera comparé à une simulation placebo, c’est-à-dire sans champ magnétique.
Si les résultats sont concluants, cette approche pourrait transformer la prise en charge des personnes vivant avec la schizophrénie en leur offrant une option thérapeutique sécuritaire, bien tolérée et plus accessible.

Une visée beaucoup plus large
Mais ce projet de recherche ne se développe pas en vase clos.
Il est le résultat d’une collaboration active entre trois centres de recherche en santé mentale de pointe au Québec : le centre de recherche Douglas, le centre CERVO à Québec, et l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM).
Cette collaboration fructueuse est chapeautée par l’Alliance Santé Mentale Québec (ASMQ), une initiative soutenue par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQ-S) et lancée en 2024 pour stimuler l’innovation en santé mentale.
L’ASMQ repose sur une conviction simple et à la fois ambitieuse : c’est en partageant nos données, nos outils, nos compétences et nos perspectives que l’on peut relever les défis complexes de la santé mentale.
La recherche en santé mentale exige aujourd’hui des ressources spécialisées, des bases de données robustes, des infrastructures de pointe et des expertises diversifiées.
Aucun centre de recherche ne peut à lui seul répondre à toutes ces exigences. En misant sur la mise en commun de ces ressources, l’ASMQ accélère le développement de traitements novateurs. Elle assure aussi une meilleure validité scientifique grâce à un partage d’accès à des échantillons vastes et diversifiés à travers la province.
Au total, plus de 60 personnes collaborent au sein de l’ASMQ, dont une quarantaine de chercheurs et chercheuses.
Explorer, comprendre et soigner
Outre l’étude de la rTMS accélérée chez les personnes vivant avec la schizophrénie, deux autres projets scientifiques au sein de l’ASMQ illustrent la richesse de cette collaboration.
Le premier, dirigé par le Dr Lionel Caihol (IUSMM), évalue l’efficacité d’une autre technique de neuromodulation, la stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS), qui pourrait être administrée à domicile chez des personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite. Cette approche, peu coûteuse et facilement accessible, pourrait élargir les options de traitement pour les personnes vivant dans les régions éloignées.
Un deuxième projet, mené par le Dr Sébastien Brodeur (CERVO), analyse plus de dix ans de données cliniques sur l’usage de la rTMS au Québec. L’objectif est de mieux comprendre l’impact réel d’une telle technique dans la pratique, au-delà des essais cliniques, et de guider les décisions en matière de traitement.
Dans chacun de ces projets, des patients partenaires, des patients partenaires, c’est-à-dire des personnes ayant une expérience vécue du système de santé et qui contribuent activement à la recherche, et des étudiants aux cycles supérieurs, dont les auteurs de cet article, participent activement à la démarche de recherche.
Cette collaboration intersectorielle permet non seulement d’ancrer les projets dans la réalité vécue des personnes concernées, mais aussi de former une relève scientifique sensible aux enjeux cliniques.
L’ASMQ incarne ainsi un nouveau modèle de recherche en santé mentale, encore plus ancré sur la collaboration, l’ouverture et l’innovation.
En misant sur le travail collectif, elle favorise un véritable transfert des connaissances vers les soins.
Mais par-dessus tout, elle donne corps à une promesse : celle de traitements plus efficaces, plus accessibles et plus humains pour les personnes composant avec un trouble de santé mentale.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.