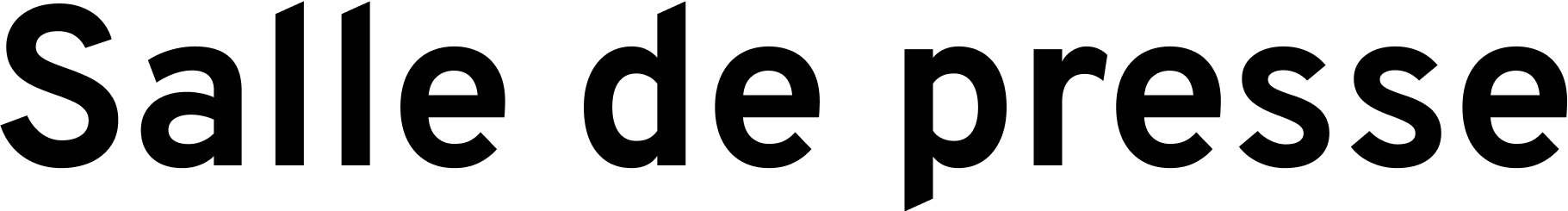28 février 2025
Au-delà de ses règles et de ses institutions, la démocratie est un mode de vie
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

La démocratie implique des règles de fonctionnement précises, mais aussi une manière d’être, ce que les Grecs appelaient un éthos.
— Shutterstock
Un texte signé par Jean-Marc Narbonne, professeur à la Faculté de philosophie.
Il est courant de parler de la démocratie comme d’un certain type de régime politique, à savoir une organisation impliquant des règles de fonctionnement particulières, des institutions diverses, des commissions, des processus de consultations, etc. La démocratie est alors conçue comme un « système » en lui-même, avec par exemple des instances séparées du pouvoir comme le « législatif », le « juridique » et l’« exécutif ».
Cette représentation des choses est juste et il n’y a pas lieu de la remettre en cause, mais en même temps, elle concerne seulement l’armature de la démocratie, ou son squelette. Ce n’est pas son souffle ou sa vie, ce n’est pas le sang qui irrigue le système et qui le met en mouvement.
Tout aussi importante, voire plus importante encore, s’avère la manière d’être ou la forme de vie (Lebensform) qu’implique un tel régime, ce que les Grecs appelaient un éthos.
Spécialiste de la philosophie grecque et de la manière dont elle a influencé le développement de la démocratie et de la culture occidentales contemporaines, je fais depuis 30 ans un incessant va-et-vient entre le passé et le présent, les anciens et les contemporains.
Vous pouvez assister à un entretien avec le chercheur Jean-Marc Narbonne, lauréat de la Médaille d’or des prix Impacts 2024 décernée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le mercredi 5 mars, dans le cadre d’un partenariat avec La Conversation Canada. Cliquez ici pour vous inscrire.
La démocratie, une entreprise partagée
On a beau disposer des meilleures règles du monde, si personne ne les suit, si la réceptivité à l’égard des mesures proposées fait défaut, alors la structure elle-même se révèle inutile ou inopérante.
Aristote déjà rappelait clairement cette exigence dans son ouvrage Politique.) :
Car aucune des lois les plus utiles ne sera du moindre profit […] si les citoyens ne sont pas accoutumés, c’est-à-dire éduqués dans la perspective de la constitution, à vivre démocratiquement, si les lois sont démocratiques, et oligarchiquement, si elles sont oligarchiques.
Les deux termes cruciaux, ici, sont être accoutumés, être éduqués, en lien avec le régime dans lequel on vit. On comprend ainsi qu’il faut non seulement adhérer théoriquement aux principes de la démocratie, mais être rompu à ses usages, ce qui exige éducation et habitudes de vie.
Chacun d’entre nous doit contribuer à cette éducation, à la maison et à l’école, entre amis et au travail. Ce n’est pas seulement le rôle de l’État. Il n’y a pas de maître en matière de démocratie, c’est une entreprise partagée.
De cette exigence, voici un exemple très simple, en lien avec l’exercice du pouvoir.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Si vous obtenez démocratiquement le pouvoir, vous comptez sur le fait que vos concitoyens ne prendront pas les armes pour vous le dérober. Réciproquement, si c’est moi qui obtiens le pouvoir, je m’attends à ce que les autres ne tentent pas non plus de me le ravir par la force.
Il s’agit-là d’un pacte préalable, implicite, mais fondamental. Si une telle entente réciproque ne prévaut pas, la démocratie ne peut s’instaurer, peu importe les lois que l’on pourrait vouloir édicter. Dans son fonctionnement interne, la démocratie n’a d’autre défense que cette renonciation réciproque à la violence, et partant, la recherche de compromis sous une forme ou sous une autre.
La démocratie, pas facile à instaurer ou à exporter
En songeant au nombre de pays où un tel modus vivendi a cours, on a d’emblée une idée des lieux où la démocratie peut effectivement s’épanouir, et des lieux où elle ne peut s’instaurer ou être introduite, en tout cas facilement.
Par où commencer ?
C’est là toute la difficulté. Si le renoncement réciproque à la force n’est pas déjà établi, si l’habitude de recourir à la raison et à la délibération commune pour trouver des accommodements n’est pas présente, initier le processus peut s’avérer difficile, voire contreproductif.
C’est ce que n’ont pas compris, ou bien mesuré à tout le moins, les pays qui ont voulu d’un seul coup exporter la démocratie dans des lieux aux mœurs éloignées de ce genre de pratiques. Ils ont pensé qu’il suffisait d’y organiser des élections et d’y établir certaines lois pour transformer les pratiques. Bien que la tâche soit difficile, elle n’est cependant pas impossible. On a vu plusieurs pays s’initier peu à peu à ce mode de vie et s’y conformer avec succès, que l’on pense au Japon, à la Corée du Sud, à l’Inde et à plusieurs autres pays d’Amérique du Sud ou d’ailleurs. Il y a donc lieu de garder espoir.
Le principe de la sagesse cumulative
À la base de toute démocratie, il y a cette idée que ce sont les citoyens qui constituent le centre de gravité de la vie politique. C’est donc d’eux qu’il faut partir.
Le respect dû aux citoyens implique la reconnaissance de leur égalité devant la loi, de leur liberté relative au sein du groupe (les citoyens ne doivent pas être des otages de l’État), de leur droit d’accès aux différentes fonctions (principe de l’alternance des charges) et à la participation active dans la résolution des problèmes (délibération commune). C’est de l’effort concerté de tous que les meilleurs résultats pourront s’ensuivre (sagesse cumulative).
Tous ces éléments impliquent une certaine manière simultanément de vivre et de penser, un mode global d’appréciation des choses à la fois par l’esprit et par l’exercice. Bref, ce que l’on peut comprendre comme une forme de vie (Lebensform) où s’entremêlent, désormais devenus indistinguables l’un de l’autre, apprentissage et pratique.
Là se situe, à mes yeux, le cœur vibrant de la démocratie, et le véritable ressort, finalement, de sa survie.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.