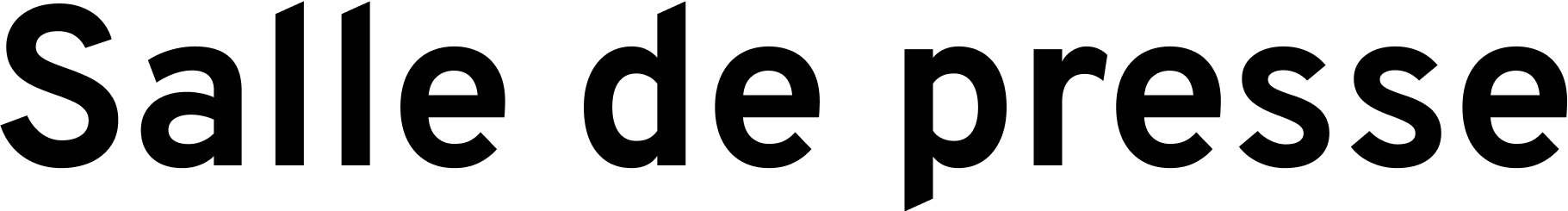1 avril 2025
Et si l’avenir du Canada passait par l’Europe?
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

Le premier ministre Mark Carney s’est envolé pour l’Europe à l’occasion de son premier voyage officiel, boudant ainsi la Maison-Blanche contrairement à la coutume. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris, puis le roi Charles III et le premier ministre britannique Keir Starmer à Londres.
— La Presse canadienne/Sean Kilpatrick
Un texte cosigné par Érick Duchesne, professeur à la Faculté des sciences sociales et membre de l’École supérieure d’études internationales.
Le Canada se retrouve aujourd’hui coincé entre deux géants aux intérêts divergents : les États-Unis et la Chine. Il subit les contrecoups des tensions commerciales et géopolitiques qui opposent ces deux puissances.
D’un côté, un voisin américain imprévisible et moins fiable, de l’autre, une Chine peu conciliante, qui impose régulièrement des sanctions économiques sur des produits agricoles stratégiques comme le soja ou le porc.
Ce contexte expose la vulnérabilité géopolitique du Canada, trop dépendant de ses partenaires traditionnels.
Nous sommes respectivement politologue et économiste, spécialisés en économie politique internationale. Notre intérêt pour le multilatéralisme économique, la géoéconomie et les relations transatlantiques nous a poussés à réfléchir aux possibilités concrètes de resserrer les liens entre le Canada et l’Union européenne.
L’influence des États-Unis vacille
Le second mandat de Donald Trump a accentué le déclin du leadership moral des États-Unis. En multipliant les retraits d’accords multilatéraux, en affichant une proximité avec des régimes autoritaires et en ravivant les accusations infondées de fraude électorale, l’administration a fragilisé la position des États-Unis comme modèle démocratique et acteur de confiance sur la scène internationale.
Les tensions transatlantiques se sont intensifiées sous l’effet des menaces répétées de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’OTAN, remettant en cause le socle sécuritaire de l’alliance. À cela s’ajoute l’impasse des négociations commerciales entre Washington et Bruxelles, illustrant les divergences croissantes sur les règles du commerce international et la protection des industries stratégiques.
La Chine n’est pas une alternative crédible
Bien qu’en pleine ascension économique, les autorités chinoises n’incarnent pas une alternative crédible au retrait américain : leur diplomatie coercitive, leur manque de transparence, leurs tensions internes, notamment financières (leur secteur immobilier est en grande difficulté),limitent leur attractivité comme leader mondial.
Depuis l’arrestation en 2018 à Vancouver de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, à la demande des États-Unis, les relations sino-canadiennes se sont considérablement détériorées. En représailles, la Chine a arrêté deux citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, suscitant une vive crise diplomatique. Depuis, la méfiance s’est profondément enracinée, alimentée par des tensions persistantes autour de la cybersécurité, de l’ingérence étrangère et des restrictions commerciales, mais aussi par l’exécution récente en Chine de quatre citoyens canadiens, condamés pour trafic de drogue.
UE : une complémentarité économique et stratégique
Dans ce contexte mondial, l’Union européenne est de plus en plus confrontée à la nécessité de construire une autonomie stratégique, tant sur le plan militaire qu’économique, pour garantir sa souveraineté et sa stabilité à long terme.
Pour devenir un pôle stabilisateur, l’Union européenne doit réunir trois conditions : disposer d’une puissance économique suffisante, faire preuve d’une volonté politique d’agir collectivement, et être perçue comme un acteur légitime et crédible par les autres démocraties. Dans cette perspective, le Canada apparaît comme un partenaire naturel et fiable.
Sur le plan commercial, les bases d’un partenariat renforcé sont déjà là.
L’Union européenne est le deuxième partenaire du Canada après les États-Unis. En 2023, les échanges de biens et de services combinés entre le Canada et l’UE ont atteint une valeur de 157,3 milliards de dollars canadiens. L’Accord économique et commercial global (AECG), en vigueur provisoire depuis 2017, a supprimé 98 % des droits de douane entre les deux partenaires, favorisant une croissance soutenue des échanges.
Mais une intégration plus poussée offrirait un accès complet au marché unique européen, une harmonisation des normes, et des synergies dans des secteurs clés : technologies vertes, intelligence artificielle, pharmaceutique ou cybersécurité. Le Canada pourrait aussi accéder à des programmes européens majeurs comme Horizon Europe, un fonds de recherche de 95,5 milliards d’euros (près de 148 G$ CAN).
Par ailleurs, le Canada détient des (ressources naturelles cruciales pour la transition énergétique européenne) : lithium, cobalt, nickel. Une collaboration renforcée permettrait d’assurer un approvisionnement sécurisé et durable tout en favorisant les industries stratégiques des deux côtés de l’Atlantique.
Défense et sécurité : vers un pilier transatlantique
Sur le plan géopolitique, l’Union européenne amorce un virage important.
Elle développe une politique de défense commune, soutenue par un budget de 800 milliards d’euros (1237 G$ CAN) et confortée par le rapport Draghi, lequel appelle à une autonomie stratégique renforcée, y compris par la consolidation d’une base industrielle et technologique de défense.
L’Allemagne, rompant avec sa tradition de rigueur budgétaire, investit massivement dans ses capacités militaires. L’Europe ne veut plus seulement se défendre aux côtés des États-Unis, mais aussi s’émanciper d’une Amérique imprévisible.
Le Canada, fidèle allié de l’OTAN et partisan d’un ordre fondé sur le droit, pourrait jouer un rôle dans les coalitions de volontaires (un plan pour soutenir l’Ukraine pris à la suite du sommet de Londres, en mars 2025) au sein de l’UE, sans attendre l’unanimité des 27. Sa participation permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action européenne sur la scène internationale.
Vers une adhésion ?
L’idée d’une adhésion du Canada à l’Union européenne est ambitieuse, mais elle n’est pas dénuée de logique.
Le Canada respecte les critères de Copenhague (État de droit, démocratie, économie de marché) et partage les valeurs fondamentales de l’Union. Les principaux obstacles seraient plutôt d’ordre technique ou politique : l’éloignement géographique, la nécessité pour le Canada d’aligner ses lois et réglementations sur l’ensemble des normes européennes (l’acquis communautaire), ainsi que l’adaptation de son système de gestion de l’offre en agriculture aux règles du marché intérieur européen.
Cependant, cette perspective ne doit pas être abordée de manière binaire. Il n’est pas nécessaire de viser une adhésion formelle immédiate. Un partenariat stratégique structurant, inspiré des modèles norvégien ou suisse, mais adapté aux réalités canadiennes, pourrait offrir une voie plus flexible.
Une telle coopération pourrait inclure l’accès renforcé aux marchés européens, la participation à des projets communs de recherche, de défense ou de transition énergétique, et une coordination accrue dans les institutions multilatérales.
L’objectif ne serait pas seulement économique, mais aussi politique et symbolique : affirmer un engagement commun en faveur de la démocratie, de la coopération internationale et du respect de l’ordre juridique mondial.
Un tournant stratégique pour le Canada
Dans un monde en recomposition, le Canada ne peut plus compter uniquement sur son ancrage nord-américain. Il doit diversifier ses partenariats et renforcer son autonomie stratégique. Le lien transatlantique, s’il est repensé dans une optique moderne et flexible, peut offrir cette alternative.
Un rapprochement avec l’Europe pourrait aussi contribuer à revitaliser le débat démocratique au Canada, à renforcer la cohésion nationale autour d’un projet commun et sa capacité à faire face aux crises futures, qu’elles soient économiques, sécuritaires ou climatiques.
Le moment est venu d’ouvrir ce débat, non pas comme un fantasme, mais comme un exercice de prospective stratégique. Le futur du Canada pourrait bien se dessiner, en partie, de l’autre côté de l’Atlantique.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.