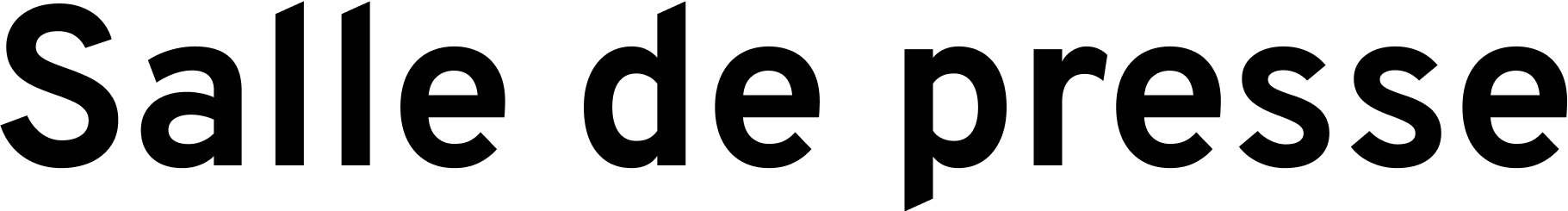19 février 2025
La guerre en Ukraine est-elle en voie d’être résolue?
Cet article est tiré de The Conversation, un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant qui publie des articles grand public écrits par des scientifiques et des universitaires, dont l'Université Laval est partenaire.

Sur cette photo fournie par le service de presse de la 24e brigade mécanisée d'Ukraine, des militaires ukrainiens tirent un missile en direction des positions de l'armée russe près de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 15 février 2025.
— Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP
Un texte cosigné par le professeur Renéo Lukic de la Faculté des lettres et des sciences humaines, affilié à l'École supérieure d’études internationales.
Des pourparlers de paix se sont entamés aujourd'hui à Riyad entre les Russes et les Américains,en l'absence du gouvernement ukrainien.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt annoncé reporté son voyage à Riyad, en Arabie saoudite, au 10 mars. Il devait y rencontrer demain la délégation américaine.
Le président ukrainien se trouve présentement dans le pays voisin, les Émirats arabes unis.
Tout cela survient alors que cela fera trois ans dans quelques jours, le 24 février, que la Russie a envahi son voisin ukrainien, deuxième phase d’une guerre qui a commencé par l’annexion de la Crimée en 2014.
Au courant des dernières semaines, la communauté internationale a davantage pressé les belligérants à entamer des négociations en vue de conclure un cessez-le-feu, un premier pas vers un traité de paix qui mettrait fin à cette guerre meurtrière. D’après les évaluations des services de renseignement occidentaux, au moins 800 000 soldats et civils ont été tués ou blessés ces trois dernières années.
Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont donné de chiffres officiels.
Professeur titulaire de relations internationales au Département d’histoire de l’Université Laval, ma co-auteure, Sophie Marineau, est doctorante en histoire à l’Université catholique de Louvain. Depuis 2014, la guerre en Ukraine et la réaction internationale vis-à-vis du conflit sont au centre de nos recherches respectives.
La Russie veut un tête-à-tête américain
L’Ukraine souhaite voir à la table de négociations les États-Unis, l’Union européenne (UE) et la Russie. Cette dernière, quant à elle, préfère une négociation avec les États-Unis seulement, sans présence de l’Ukraine ou de l’UE.
Selon Vladimir Poutine, la présence de Zelenski à la table de négociation est inacceptable : il est un homme politique « illégitime ».
Évidemment cette proposition est inadmissible pour Kiev. La seule position conciliable pour l’instant est donc la présence des États-Unis pour ces négociations.
Le Kremlin réclame que l’Ukraine lui cède les régions de Donetsk, de Lougansk, de Zaporijia et de Kherson, en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce à rejoindre les rangs de l’OTAN. Kiev espère de son côté récupérer les zones perdues.
La guerre ne sera pas réglée en 24 heures
La promesse électorale de Donald Trump de mettre fin à cette guerre en 24 heures est maintenant chose du passé. Une fois installé à la Maison Blanche et informé de la complexité du conflit, sa gestion a été déléguée à l’émissaire pour l’Ukraine, l’ex-général Keith Kellog.
Celui-ci croit que des négociations sont le seul moyen de mettre fin à cette guerre. Si la Russie tarde à signaler son intérêt à négocier, Keith Kellog affirme envisager d’imposer de nouvelles sanctions. Selon lui, le gouvernement américain dispose encore de leviers économiques importants pour convaincre la Russie de négocier, de bonne foi, la fin de ce conflit.
Notons que l’UE a imposé un quinzième train de sanctions contre la Russie, sans résultats concrets. Malgré le doute constant quant à leur efficacité, les sanctions demeurent le seul outil diplomatique dont disposent les alliés de l’Ukraine. À long terme, les sanctions érodent les capacités militaires et technologiques de la Russie. Mais à court terme, Moscou semble être en mesure de poursuivre la guerre.
Menacé par un mandat de la CPI, Poutine ne se déplacera pas facilement
Le lieu de ces futures négociations reste aussi incertain. La Cour Pénale internationale (CPI) a émis le mandat d’arrêt contre Poutine en 2023 l’accusant d’être responsable de crimes graves commis en Ukraine par son armée : crimes d’agression, crimes de guerre et crimes contre humanité. Il est peu probable que les 125 États adhérant à la Cour acceptent le déplacement de Poutine sur leur territoire afin que celui-ci participe aux négociations.
La situation est différente en ce qui concerne l’attitude des États-Unis à l’égard de la Cour puisque Washington ne reconnaît pas sa compétence. Le président Trump a signé un décret imposant des sanctions contre ses juges et ses assistants depuis l’émission d’un mandat d’arrêt contre le président israélien Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense. Poutine pourrait donc se rendre aux États-Unis pour des pourparlers de cessez-le-feu sans craindre d’être arrêté et envoyé à La Haye, où se trouve le siège de la CPI.
Parallèlement, avant de signer un cessez-le-feu, l’Ukraine exige de ses alliés des garanties de sécurité. Elle souhaite ainsi le déploiement sur son territoire d’environ 200 000 soldats pour garantir son maintien durable. Sans cette présence l’Ukraine pourrait être, selon Zelenski, attaquée de nouveau par la Russie et ce, dès que Moscou aura refait ses stocks d’armes.
Un accord violé
À la suite de son indépendance en 1991, l’Ukraine avait affirmé sa neutralité et son choix de devenir un État non nucléaire.
Cependant son attitude a changé durant les deux années suivantes lorsque les États-Unis et la Russie demandent à l’Ukraine de transférer les armes nucléaires de l’héritage soviétique à la Russie. En 1991, l’arsenal soviétique demeuré en territoire ukrainien fait de ce pays la troisième puissance nucléaire mondiale.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
En janvier 1994, le président américain Bill Clinton se rend à Moscou pour signer un accord avec Kiev et Moscou. Il affirme que si l’Ukraine livre les armes à la Russie, le président russe Boris Eltsine et lui-même sont en mesure de garantir l’intégrité territoriale, la sécurité et une aide économique pour le nouvel État.
L’accord est signé le 14 janvier 1994 et le transfert des armes se termine le 1er juin 1996. « Par cet accord, toutes les parties s’entendent pour respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Les parties s’engagent aussi à ne pas utiliser de mesures économiques coercitives ou de menaces visant à vassaliser l’Ukraine au profit de leurs propres intérêts. »
En envahissant la Crimée en 2014 et par la nouvelle offensive en 2022, la Russie a donc violé l’accord signé en 1994. Avant de signer tout autre accord avec son voisin, l’Ukraine souhaite s’assurer que celui-ci puisse être garantie par des moyens beaucoup plus concrets.
L’UE mise à l'écart
À la suite de la rencontre convoquée par le président français Emmanuel Macron, le 17 février à Paris, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, affirme que « l’Ukraine mérite la paix par la force », en respectant sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Elle assure que l’Europe assume pleinement sa part de l’assistance militaire à l’Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz soutient quant à lui qu’il est prématuré de discuter d’une force de maintien de la paix à l’heure actuelle. Si les membres de l’Union européenne souhaitent augmenter les dépenses militaires au-dessus de 2 % de leur PIB respectif, l’Allemagne supportera l’initiative.
Les premiers ministres danois, polonais, anglais et espagnol soulignent également la nécessité pour l’Europe d’augmenter ses propres capacités de défense et les budgets militaires au sein de l’organisation.
Pour ce qui est d’une force de maintien de la paix, l’envoi de 200 000 soldats est irréaliste pour l’UE. Actuellement, les médias européens spéculent sur la présence de 30 000 à 40 000 hommes, composée principalement de soldats français et britanniques.
Le Secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a quant à lui affirmé que les États-Unis n’enverraient pas de soldats en Ukraine si une force de maintien de la paix était déployée. Il estime également qu’il est irréaliste de penser que l’Ukraine retrouvera l’intégralité de son territoire pré-2022 à la signature d’un traité de paix avec la Russie.
La diplomatie américaine ne considère pas non plus la possibilité qu’un statut de membre de l’OTAN soit offert à l’Ukraine lors de ces négociations.
Le gouvernement canadien ne s’est, pour l’instant, pas prononcé sur la possibilité de contribuer à une force de maintien de la paix en Ukraine, si elle devait être établie.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.