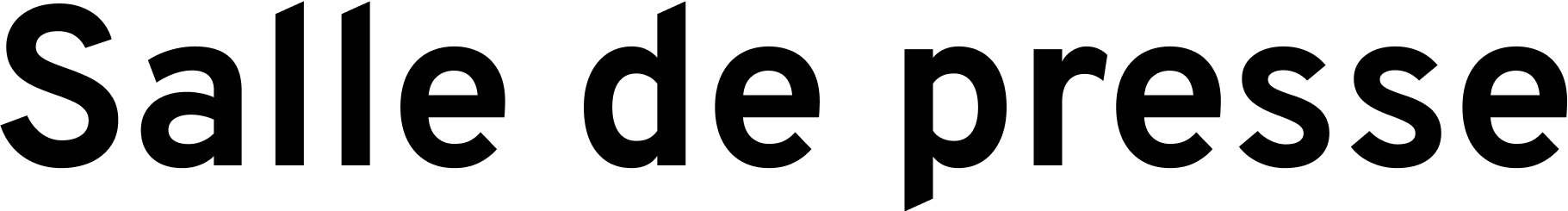Voici quelques interventions de la communauté au cours de la semaine du 21 avril.
La caravane libérale rencontre beaucoup de supporters enthousiastes en cette campagne électorale. Les gens semblent apprécier l’humour et la répartie de Mark Carney. Selon Thierry Giasson, professeur à la Faculté des sciences sociales, le néo-politicien a un style qui rompt avec celui du rhétoricien, auquel on est habitué. C’est quelqu’un qui est capable de rire de lui, alors que l’autodérision n’est pas dans le registre de Pierre Poilievre.
L’erre d’aller de Mark Carney (La Presse)
Le programme de régionalisation des demandeurs d’asile n’existera plus dans la Capitale-Nationale. Selon Stéphanie Arsenault, professeure à la Faculté des sciences sociales, cette coupe est incompréhensibles. Les demandeurs d’asile fuient la persécution et arrivent extrêmement hypothéqués, avec un lourd bagage psychosocial. L’économie financière ne justifie pas la perte de services pour eux.
Abolition des services pour les demandeurs d’asile à Québec (Radio-Canada)
Pour appuyer l’économie forestière, un projet de loi vise à réserver à perpétuité le tiers des forêts publiques québécoises à l’industrie. Selon Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, c’est la première fois qu’une loi sectorielle limiterait la souveraineté de l’État sur une partie significative du territoire et empêcherait un futur gouvernement de protéger, par exemple, des bandes riveraines.
Près du tiers des forêts publiques réservées à l’industrie forestière (La Presse)
Le projet de mine de pouzzolane à Dalhousie est présenté comme un moyen de lutter contre le changement climatique. Selon Marc Jolin, professeur à la Faculté des sciences et de génie, utiliser de la pouzzolane dans la fabrication de béton est une bonne idée pour réduire le CO2. Par contre, une mine a des impacts environnemenatux et il est difficile de dire si le jeu en vaut la chandelle. Il faudrait une vraie analyse de cycle de vie pour se prononcer.
Une mine «verte»? (La Presse)
Plusieurs fois malmené, le système de la gestion de l'offre est une fois encore sur la sellette. On lui reproche de maintenir artificiellement des prix trop élevés. Annie Royer, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, n’a jamais vu d’étude assez solide pour la convaincre que les prix sont trop chers. Selon elle, ce système n’est pas parfait, mais il est bénéfique pour l'autonomie alimentaire, la qualité des produits et la vitalité des régions.
Le b.a.-ba de la gestion de l’offre au Canada (Le Devoir)
Le gouvernement américain a annoncé un plan pour bannir huit colorants synthétiques à base de pétrole d’ici la fin 2026. Cette décision relève davantage de la propagande que de la recherche scientifique. Présentement, sept des huit produits sont permis au Canada. Selon Benoît Lamarche, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, si le Canada décidait de les bannir également, les Canadiens seraient gagnants.
Huit colorants alimentaires nocifs pour la santé seront interdits dans les bonbons, céréales et boissons sucrées aux États-Unis (Le Journal de Québec)
Un pays est considéré comme «sûr» s’il offre aux personnes réfugiées une véritable protection contre le refoulement, un accès équitable à la procédure d’asile et des conditions de détention conformes aux droits fondamentaux. Selon Adèle Garnier, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, il sera difficile de considérer les États-Unis comme un pays sûr à partir du moment où il n’y aura plus aucun accès à la procédure d’asile.
Les États-Unis sont-ils encore un pays sûr? (La Presse)
Une étude de 2014 a analysé le discours tenu autour de Mark Carney, qualifié de « superhéros sexy » lorsqu’il a été nommé à tête de la Banque d’Angleterre. L’étude conclut que ce narratif a normalisé la domination masculine en économie. Sylvie Morel, professeure retraitée de la Faculté des sciences sociales, croit qu’il s’agit de mythes et que l’entrée dans une crise, par exemple, n’est pas réductible aux folies d’une masculinité d’affaires transnationale.
Masculinité en finances: une étude place Mark Carney sous la loupe (Francopresse)
S’il est élu premier ministre, Mark Carney s'engage à atteindre un seuil de 12% d'immigration francophone hors Québec d'ici 2029. Selon Jean-Pierre Corbeil, professeur associé à la Faculté des sciences sociales, il n'est pas suffisant d'avoir le français comme langue première si on ne fait qu'utiliser l'anglais au quotidien et qu'on n'encourage pas le bilinguisme chez les anglophones.
La cible d’immigration francophone de 12%, une approche «simpliste» (Le Devoir)
Personne ne gagne avec la stratégie des tarifs douaniers de Donald Trump, a déclaré Arthur Silve, professeur à la Faculté des sciences sociales, qui qualifie la situation économique mondiale de «bordel». Il a ajouté que même les riches s’appauvriront puisqu’ils verront leur capitalisation boursière fondre comme neige au soleil.
Guerre commerciale avec la Chine: «Même les riches vont perdre », estime un expert» (Le Journal de Québec)
Une lettre d’opinion signée par plus de 500 professeurs canadiens critique l’administration Trump et enjoint le prochain gouvernement canadien à mieux financer la recherche. Selon Jesse Greener, professeur à la Faculté des sciences et de génie, les universités canadiennes souffrent d’un sous-financement chronique. Aimée Dawson, professeure à la Faculté de médecine dentaire croit, quant à elle, que le Canada pourrait saisir l’occasion de transformer son système d’enseignement supérieur en refuge.
Des professeurs appellent à offrir un sanctuaire au Canada (La Presse canadienne via La Presse)
Les universités nord-américaines font actuellement l’objet d’attaques qui menacent leur autonomie. Les professeurs Nolywé Delannon de la Faculté des sciences de l’administration, Louis-Philippe Lampron de la Faculté de droit, Laura Monetta de la Faculté de médecine et Simon Viviers de la Faculté des sciences de l’éducation ont signé une lettre d’opinion pour affirmer que l’autonomie de l’Université Laval devrait être défendue par une structure collégiale de gouvernance.
Face à l’urgence de renforcer (collégialement) l’Université Laval (Le Soleil)
À l’annonce du décès du pape François, Gilles Routhier, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, a rappelé que la première prise de position forte de ce pape concernait le devoir d’accueillir les migrants. Il a ajouté que François a aussi avancé dans le rapport avec les autres religions, en particulier avec les juifs et les musulmans.
Le pape François est décédé à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican (Noovo Info)
Quelques heures avant sa mort, dans son homélie de Pâques qui a été lue par un proche, le pape François a, entre autres, dénoncé plusieurs conflits armés dans le monde ainsi que le climat d’antisémitisme croissant. Selon Gilles Routhier, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, il s’agissait d’un dernier message dans la continuité, avec un signal fort en faveur de la paix et du désarmement.
Le dernier message pascal d’un pape (La Presse)
Il est difficile de dissocier l’effet qu’a eu la grippe aviaire sur le prix des œufs aux États-Unis de leur modèle de production, estime Maurice Doyon, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Il ajoute que ce modèle est basé sur une dynamique économique de bubble and burst, ce qui permet de très grandes fluctuations de prix.
Le modèle américain «indissociable» des effets de la grippe aviaire sur les prix (La Terre de chez nous)
Dans le cadre de ses efforts de réductions budgétaires et de réorganisation des services aux entreprises, le gouvernement du Québec a porté quelques coups durs au soutien à l’entrepreneuriat, comme le rappellent Matthias Pepin et Mariepier Tremblay, professeurs à la Faculté des sciences de l’administration, dans une lettre d’opinion qu’ils signent. Selon eux, la réussite des entreprises dépend d’organismes qui donnent des conseils et un soutien financier.
Coups durs pour l’entrepreneuriat (Le Devoir)
Il est très hasardeux de prédire le prochain pape étant donné que la composition du conclave a beaucoup changé pendant le pontificat de François. Les archidiocèses de Paris, Cologne et Milan, par exemple, ne seront pas représentés. D’un autre côté, indique Gilles Routhier, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, le nombre de cardinaux issus de l’Asie est passé de 10 à 30. Le poids de l’Église a changé à travers le monde.
Qui succédera au pape François? (Le Journal de Québec)
Des candidats au scrutin fédéral sont très actifs sur les réseaux sociaux. Les campagnes numériques permettent d’atteindre des publics précis en fonction de l’âge, du genre, du revenu ou des intérêts. Selon Thierry Giasson, professeur à la Faculté des sciences sociales, ces campagnes peuvent se faire de façon presque granulaire, en plus d’être moins chères et plus efficaces que les campagnes traditionnelles à la télévision ou dans les journaux.
La campagne électorale que vous n’avez (sûrement) pas vue (Radio-Canada)
La veille de son décès, le pape François a posé un dernier geste politique. Selon Gilles Routhier, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, son message urbi et orbi de Pâques peut être lu comme un commentaire sur la politique américaine. En parlant de liberté d’expression, le pape a pris à contre-pied le discours du vice-président Vance, qui a soutenu que la liberté d’expression est menacée par les restrictions européennes envers l’extrême droite.
Le pape François n’est plus (La Presse)
Depuis 1995, le chroniqueur Michel David publie à la fin de chaque session parlementaire des bulletins dans lesquels il évalue la performance des élus québécois. Dans un texte qu’il signe, Marc André Bodet, professeur à la Faculté des sciences sociales, indique que les députés les mieux notés par Michel David tendent fortement à se représenter aux élections suivantes.
Les bulletins parlementaires de Michel David, évaluations ou prédictions? (Le Devoir)
Les raffineries du Texas transforment le pétrole lourd canadien en brut léger, dont une partie est exportée au Québec, qui l’utilise pour produire différents carburants. Les exportations texanes vers le Québec représentent 9,6 G$. Ce chiffre n’étonne pas Patrick Gonzalez, professeur à la Faculté des sciences sociales, qui croit que le Québec a tout de même fait un choix légitime en n’exploitant pas les ressources pétrolières sur son territoire et en misant sur des ressources renouvelables.
Industrie pétrolière: «Le Canada a fait de mauvais choix», selon un expert du Texas (Radio-Canada)
Les systèmes alimentaires territoriaux (SAT) se définissent comme une approche territoriale et systémique qui cherche le bien-être de la population en cohérence avec les ressources naturelles disponibles. Selon Laurence Guillaumie, professeure à la Faculté des sciences infirmières, les SAT visent une planification stratégique intersectorielle qui permet d’éviter de travailler en vase clos.
Des systèmes alimentaires territoriaux pour l’avenir agricole (Le Devoir)
La gestion de l’offre est une entente entre le gouvernement et les producteurs de lait, de volaille et d’œufs qui fixe les prix que vont recevoir les agriculteurs selon les coûts de production. Maurice Doyon, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, explique que ce système repose sur un coût de production moyen. Un producteur a donc intérêt à faire mieux que la moyenne pour obtenir une bonification.
Gestion de l’offre 101 (La Presse)
Le secteur agricole pourrait être mis davantage à profit pour lutter contre le changement climatique. Deux options se présentent contre le CO2: réduire les émissions et favoriser la séquestration de carbone dans le sol. Selon Marie-Élise Samson, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, la première option permet d'agir plus vite, mais la seconde génère davantage de cobénéfices, comme un sol en bonne santé chimique, physique et biologique.
Pas encore de prime verte pour les agriculteurs qui améliorent leur bilan carbone (Le Devoir)
Plusieurs assureurs délaissent le marché des maisons anciennes ou patrimoniales. Selon Étienne Berthold, professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, rénover ces bâtiments coûte cher parce qu’on doit se rapprocher d’une authenticité. Le parc immobilier des maisons anciennes exige une expertise, ce qui explique que peu de compagnies d’assurance se le partagent.
Une question de statut (La Presse)
Devant les tarifs douaniers de Donald Trump, des politiciens canadiens proposent de devancer la renégociation de l’Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) prévue en juillet 2026. Selon Richard Ouellet, professeur à la Faculté de droit, il s’agit d’une fausse bonne idée. Dans un texte d’opinion qu’il signe, il explique que l’appui populaire en faveur du président ne peut que baisser. La patience jouera donc en faveur du Canada.
Cinq bonnes raisons de ne pas négocier trop vite (La Presse)
Américains et Iraniens se sont retrouvés à Rome pour un deuxième tour de pourparlers sur l’épineux dossier du programme nucléaire iranien. Selon Jonathan Paquin, professeur à la Faculté des sciences sociales, une progression diplomatique rapide pourrait survenir, et les pourparlers – pour le moment indirects – pourraient se transformer en négociations directes entre les deux États.
Pourquoi le nucléaire iranien est au cœur de négociations entre Washington et Téhéran (Radio-Canada)
Thierry Giasson, professeur à la Faculté des sciences sociales, a été appelé à commenter la performance des participants aux deux débats des chefs. Selon lui, Pierre Poilievre s’est davantage exprimé comme un chef de l’opposition que comme un premier ministre, alors que Mark Carney a fait figure d’adulte dans la pièce. Pour leur part, Yves-François Blanchet est celui qui a le plus parlé des réalités propres au Québec et Jagmeet Singh a été la voix du bon sens.
La performance des chefs vue par des experts (La Presse)
Après avoir maintenu le marché du carbone, le gouvernement Legault a annoncé qu’il supprimait le prix plancher de l’essence, une mesure en vigueur depuis les années 1990. Selon Eric Montigny, professeur à la Faculté des sciences sociales, il s’agit pour le gouvernement d’un moyen de se montrer «proactif» sur une question qui est au centre des préoccupations.
Le prix plancher de l’essence ne se fera pas sentir à la pompe (Noovo Info)
À l’occasion d’un colloque sur la transition énergétique à Carleton-sur-Mer, des spécialistes expliquent qu’il n’est pas nécessaire d’acheter une auto électrique pour lutter contre le changement climatique. Parmi eux, Dominique Morin, professeur à la Faculté des sciences sociales, soutient que, contrairement à la croyance populaire, ça ne coûte pas cher de faire sa part pour l’environnement. Le logement, notamment, est un aspect à envisager.
Transition énergétique: commencer à la maison plutôt que sur la route (TVA Nouvelles)