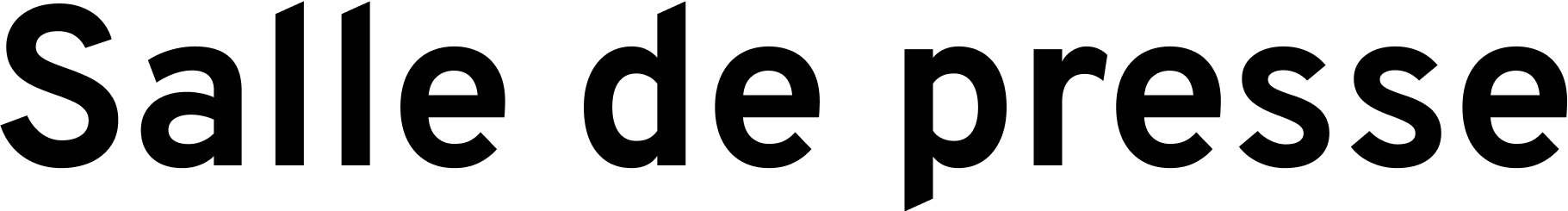Voici quelques interventions de la communauté au cours de la semaine du 17 mars.
Un chroniqueur du quotidien The Telegraph décrivait le passage de Mark Carney à la Bank of England comme un échec et lui reprochait l’inflation que le Royaume-Uni a traversée pendant la pandémie. Selon Stephen Gordon, professeur à la Faculté des sciences sociales, le Royaume-Uni n’était pas complètement sorti de la crise financière de 2008 et qu’il y a eu le Brexit. M. Carney avait prévenu que si le Brexit passait, il y avait un risque de récession.
L’« échec » de Mark Carney à la Banque d’Angleterre… (Le Soleil)Maintenant que le 23e premier ministre du Canada a tiré sa révérence, l’heure est au bilan. Est-ce que Justin Trudeau a rempli ses promesses après neuf ans à gouverner le pays ? Alexandre Fortier-Chouinard, professionnel de recherche, et Lisa Maureen Birch, professeure à la Faculté des sciences sociales, expliquent les constats du Polimètre Trudeau, sous leur responsabilité.
Que restera-t-il du legs de Justin Trudeau ? (Journal de Québec)Pelican International s’est servi de prêts pour remettre 60 M$ dans les poches de ses actionnaires en « dividendes spéciaux ». Le géant québécois des kayaks et canoës est devenu insolvable et sur le point d’être vendu. Selon Carl Brousseau, professeur à la Faculté des sciences de l’administration, si elle avait gardé un coussin plutôt que de verser un dividende, elle aurait pu gagner du temps et l’entreprise ne serait pas dans cette situation.
Insolvabilité – Pelican fragilisé par ses cadeaux aux actionnaires (La Presse)Pierre Poilievre sera le seul des chefs fédéraux à sillonner le pays sans être étroitement suivi par des médias durant la campagne électorale. Le Parti conservateur a décidé de bannir les journalistes de l’avion du dirigeant. Selon Colette Brin, professeure à la Faculté des lettres et des sciences humaines, c’est une façon de tenir les reporters politiques à l’écart, car il considère que les journalistes sont plus critiques de leur parti que du Parti libéral.
Campagne conservatrice – Les médias laissés derrière (La Presse)Anne-Marie Delagrave, professeure à la Faculté de droit, cosigne un texte d’opinion sur le conflit entre les approches formalistes, restrictives ou littérales du droit constitutionnel en vigueur, et les approches « sociales » ou larges et « généreuses », qui produit des jugements hautement contradictoires. Selon les signataires, ce conflit est apparu dans les années 1980, à l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, et demeure vif.
Les libertés syndicales entre formalisme restrictif et approches sociales (Le Devoir)L’échange de Patrick Roy et Mike Keane à l’Avalanche du Colorado contre Jocelyn Thibault, Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky, en décembre 1995, a causé un séisme médiatique dont on ressent encore les répliques. Philippe Lamothe, étudiant en histoire à la Faculté des lettres et des sciences humaines, a consacré son mémoire de maîtrise aux liens entre le départ du gardien du Canadien et le contexte social de l’époque.
Le Royférendum analysé à l’université (La Presse)Tomber enceinte n’est pas toujours simple et le fardeau se fait souvent porter par la femme. Pourtant, dans environ 50 % des cas d’infertilité au sein des couples, la cause d’origine est masculine. Selon Pierre Leclerc, professeur à la Faculté de médecine, bien que les mentalités évoluent, les premiers examens en clinique de fertilité ciblent principalement les femmes. Il estime que les recherches sur l’infertilité doivent être élargies.
Infertilité : un tabou persistant malgré les avancées médicales (Le Quotidien)Le Canada exporte la majorité de sa production pétrolière vers les États-Unis pour le traitement et la consommation. Patrick Gonzalez, professeur à la Faculté des sciences sociales, rappelle que le Québec a décidé de ne pas exploiter les ressources pétrolières et gazières sur son territoire. Selon lui, ce choix est légitime et reflète une volonté de miser sur les ressources renouvelables dans le futur.
Industrie pétrolière : « Le Canada a fait de mauvais choix », selon un expert du Texas (Radio-Canada)Des clients d’HelloFresh ont été choqués de découvrir, dans leur boîte-repas, une publicité d’une clinique virtuelle offrant la prescription d’Ozempic. Cette association est extrêmement préoccupante, selon Benoît Arsenault, professeur à la Faculté de médecine. On vient exploiter la vulnérabilité des personnes à risque de développer des troubles de l’image corporelle ou de comportement alimentaire dans le but de leur vendre des consultations.
Elle reçoit une pub d’Ozempic dans sa boîte HelloFresh : « Un énorme what the fu*k » (Journal de Québec)L’environnement actuel où il y a énormément d’incertitudes est un gros problème pour bien des entreprises qui font du commerce transfrontalier, observe Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration. S’il y avait des tarifs qui étaient imposés une fois pour toutes, on serait déçu, mais il y aurait une certitude dans l’environnement qui permettrait aux entreprises de faire des gestes pour se défendre contre les tarifs.
La guerre commerciale menace le principal producteur de bâtons de hockey au Canada (Radio-Canada)En péril financier, La Baie d’Hudson veut éviter de tirer sa révérence. L’âge d’or des colosses du détail est maintenant loin derrière nous. Selon Maryse Côté-Hamel, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, la chaîne ne s’est pas adaptée à la recherche d’options qualité-prix qui s’est enracinée dans les habitudes d’achat. On voit qu’il y avait de nombreux concurrents qui offraient une majorité des produits à de meilleurs prix.
L’ère des grands magasins tire à sa fin (Le Soleil)La Compagnie de la Baie d’Hudson s’est placée à l’abri de ses créanciers, début mars. Selon Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration, La Baie a su se réinventer à plein de moments de son histoire, mais cette fois-ci, c’est trop peu, trop tard. Il pense que la compagnie est plus appréciée des Canadiens pour ce qu’elle représente dans l’histoire du pays que pour l’expérience d’achat qu’elle propose.
Les clients se pressent à La Baie d’Hudson avant qu’il ne soit trop tard (Le Devoir)Le recours à la chirurgie pour soulager une douleur chronique se fait parfois trop rapidement, déplore une nouvelle revue systématique. Selon Anne Marie Pinard, médecin clinicienne enseignante titulaire à la Faculté de médecine, les auteurs de l’étude mettent en lumière plusieurs éléments intéressants, notamment l’existence de silos entre le traitement chirurgical et le traitement non chirurgical de la douleur lombaire.
Le recours à la chirurgie pour soulager la douleur ne serait pas toujours approprié (Noovo info)Des spécialistes dénoncent un projet de modification de l’échelle Nova, le système qui classe les aliments d’après leur degré de transformation. Le fabricant d’Ozempic finance ces travaux. Selon Jean-Philippe Drouin-Chartier, professeur à la Faculté de pharmacie, croit qu’elle risque d’être systématiquement associée à un biais potentiel. C’est une fondation financée par la vente de médicaments pour la perte de poids, ce qui est un peu particulier.
Dispute au sujet des aliments ultratransformés (La Presse)Douze débardeurs du port de Québec entameront une formation obligatoire d’une durée totale de 24 heures en prévision de leur éventuel retour au travail. Pier-Luc Bilodeau, professeur à la Faculté des sciences sociales, explique qu’avec un conflit qui était d’assez longue durée comme celui-ci, il est très possible qu’on ait besoin de mettre à jour des équipements, qu’on ait besoin de s’assurer que les formations sont à jour.
Débardeurs du port de Québec : retour graduel au travail… et formation obligatoire (Radio-Canada)Plusieurs études montrent que les gens préfèrent parler à l’IA plutôt qu’avec une personne, parce qu’ils ont peur que cette personne les juge. Une crainte confirmée par Marie-Pierre Gagnon, professeure à la Faculté des sciences infirmières. Elle prévient que c’est un couteau à double tranchant en santé, car il ne faut pas que l’IA donne son aval à des comportements risqués. Il faut qu’ils soient bien encadrés pour éviter les mauvais conseils.
Les tests antirobots sont menacés (La Presse)Les deux tiers des décès sont causés par des maladies chroniques au Canada, et, on le sait, le mode de vie y est pour beaucoup : tabac, malbouffe, usage nocif d’alcool, inactivité physique. Les professeurs François Maltais et Jean-Pierre Després, à la Faculté de médecine, abordent les habitudes de vie qui viennent ou non avec le tabac, comme la sédentarité. Le cocktail dangereux ? Alcool, obésité viscérale et inactivité physique.
Qu’est-ce qui est pire – Une cigarette, un verre d’alcool ou une poutine ? (La Presse)Même si l’industrie acéricole canadienne représente plus de 70 % de la production annuelle mondiale de sirop d’érable, le Canada importe du sirop américain chaque année. La proximité entre le Québec et certains territoires américains où poussent beaucoup d’érables peut, en autres, expliquer une partie des importations selon Maurice Doyon, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.
Pourquoi importe-t-on du sirop d’érable américain chaque année ? (Radio-Canada)L’industrie des batteries électriques promettait de se développer à la vitesse grand V il y a quelques années, mais la route de son développement est plus raboteuse que le laissaient entendre les politiciens. Les déboires financiers de l’entreprise Northvolt, en sont un exemple. Cependant, d’autres joueurs au Québec vont très bien, indique Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration.
Faillite de Northvolt : est-ce la fin de la filière batterie ? (Radio-Canada)Les effets de l’accumulation des cannebergières sur une même rivière n’ont jamais fait l’objet d’une étude scientifique avant aujourd’hui. Sivilo Gumiere, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, veut évaluer l’impact des fermes de canneberges sur l’utilisation de l’eau, dans le contexte où beaucoup de fermes de canneberges essayent d’augmenter leur surface cultivable.
La canneberge, une culture en eaux troubles (radio-Canada)Il est encore rare de tomber sur une clientèle qui demande de l’aide pour des comportements en lien avec les marchés financiers, souligne Étienne Gagnon, étudiant au doctorat à la Faculté des sciences sociales. L’une des raisons pouvant expliquer ce constat est que les marchés financiers demeurent bien perçus socialement. Il serait donc plus difficile de réaliser qu’une personne a un problème.
Accros à la Bourse comme au casino (La Presse)Une entreprise prétendant avoir pignon sur rue à Québec attire de nombreux clients avec des promesses trompeuses et des prix alléchants. Selon Marie-Ève Arbour, professeure à la Faculté de droit, peu importe que l’entreprise exerce d’une façon légale ou pas, qu’elle soit située au Québec ou à l’étranger, ça n’a pas d’impact sur le fait que la loi va protéger les consommateurs québécois.
Des clients floués par une entreprise faussement locale (Radio-Canada)Québec n’a pas l’intention d’étendre aux cégeps et aux universités les programmes spécialisés d’éducation culturelle réservés depuis des années aux écoles primaires et secondaires. Denis Simard, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation, milite pour que La culture à l’école essaime vers les cégeps et les universités. Selon lui, l’enseignement est fondamentalement une pratique culturelle.
« La culture à l’école », mais pas à l’université (Le Devoir)Les projections de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone anticipent une croissance du français dans le monde d’ici 2060 moins forte que certains l’ont cru. Selon Richard Marcoux, professeur à la Faculté des sciences sociales, ces prévisions sont en partie liées aux graves perturbations sociopolitiques que vivent plusieurs pays africains. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’être pessimiste ou jovialiste, mais réaliste.
Optimisme tempéré pour la progression du français dans le monde (Le Devoir)Le président américain se sert des migrants pour faire pression sur d’autres pays et obtenir ce qu’il veut. Cette diplomatie migratoire a des conséquences réelles sur la vie de milliers de personnes. Selon Adèle Garnier, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, dans tous les accords, les migrants sont les premiers perdants. C’est catastrophique pour eux.
Trump et la non-diplomatie migratoire (Le Devoir)La nouvelle Chaire de recherche sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques au Québec lance ses activités. Elle s’intéresse à la dynamique linguistique. Selon Richard Marcoux, professeur à la Faculté des sciences sociales et cotitulaire, ça fait longtemps que les flux migratoires sont très orientés par les aires linguistiques. Jean-Pierre Corbeil, professeur à la Faculté des sciences sociales, fait aussi partie du comité scientifique.
Explorer les liens entre immigration et langue au Québec (Le Devoir)