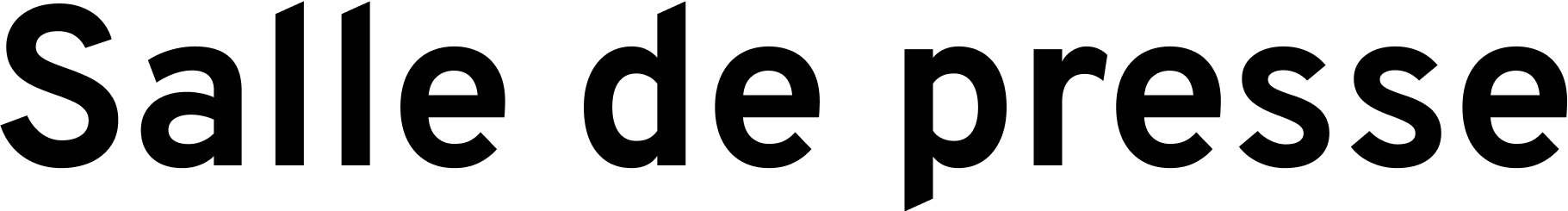Voici quelques interventions de la communauté au cours de la semaine du 4 novembre.
Donald Trump s’est engagé à mener la plus grande opération d’expulsions de l’histoire des États-Unis dès son premier jour à la Maison-Blanche. Selon Danièle Bélanger, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, il y a beaucoup de spectacles dans cette menace. Les moyens que ça va prendre, à la fois financiers et humains, et toutes les contestations que ça risque d’entraîner de différentes parties prenantes vont être énormes.
Déportation souhaitée par Donald Trump – Vers un nouvel afflux de migrants au Québec ? (La Presse)Doit-on privilégier les aliments bios ou locaux ? Selon Caroline Halde, professeure de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, encourager les producteurs locaux leur permet aussi d’avoir suffisamment de marge pour adopter de bonnes pratiques environnementales. Pour le bio, elle ajoute que ce qui a un impact majeur, c’est l’utilisation de pesticides de synthèse et d’engrais, peu importe la provenance.
Bio ou local : quel est le meilleur choix pour l’environnement ? (La Presse)Lion Électrique a connu sa pire séance boursière de l’année en plus de voir son action toucher un nouveau creux. Il doit obtenir la clémence de ses prêteurs à court terme pour garder la tête hors de l’eau. Selon Carl Brousseau, professeur à la Faculté des sciences de l’administration, sans entente, le syndicat bancaire aura des recours. On va considérer une situation de défaut. Ça veut dire qu’il en reviendra aux prêteurs de décider.
Sortie de route boursière pour Lion Électrique (La Presse)L’élection de Donald Trump pourrait faire perdre des milliards de dollars à Northvolt, au Québec, et aux projets d’usines de batteries de Volkswagen et de Stellantis-LG, en Ontario. Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration, estime que le retrait éventuel des subventions fédéral et provincial à la production pourrait se faire au détriment de l’envergure ou de la réalisation de certains projets, mais c’est trop tôt pour conclure.
Trump menace le financement canadien des usines de batteries (Radio-Canada)Donald Trump a promis d’instaurer un « mur tarifaire » allant jusqu’à 20 % sur toutes les importations qui entrent en sol américain. Selon Arthur Silve, professeur à la Faculté des sciences sociales, s’il met en place la moitié de ce qu’il a annoncé, on va avoir une spirale inflationniste immédiate, mais ce qu’il a annoncé semble impossible à mettre en place et une catastrophe pour les Américains eux-mêmes.
Mises à pied, fin des procédures judiciaires, expulsions massives d’immigrants : voici ce qui nous attend avec le retour de Donald Trump (Journal de Québec)Alors qu’un vent de panique se répand dans certaines communautés aux États-Unis, des experts croient qu’il faut se préparer dès maintenant à des vagues d’immigration à la frontière canadienne. Adèle Garnier, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, croit qu’il y a un risque d’effet de panique. Ça l’étonnerait cette fois qu’on dise qu’on va protéger des gens au Canada.
Le retour de Trump pourrait provoquer des vagues d’immigration à la frontière (Le Devoir)La menace de Donald Trump d’instaurer des tarifs douaniers de 10 % sur les produits canadiens est au cœur des inquiétudes de la communauté d’affaires de Québec. Richard Ouellet, professeur à la Faculté de droit, prévient déjà que des négociations commerciales s’annoncent ardues avec la nouvelle administration. Ça vient avec beaucoup d’imprévisibilité, ça vient aussi avec un certain unilatéralisme.
La communauté d’affaires de Québec retient son souffle avec le retour de Trump (Radio-Canada)Le président désigné Donald Trump risque-t-il de nuire au climat de la planète ? Selon Alexandre Gajevic Sayegh, professeur à la Faculté des sciences sociales, d’autres États, dont le Canada, devront redoubler d’efforts pour maintenir en vie les objectifs climatiques mondiaux. Il craint que ce soit beaucoup plus difficile à partir de maintenant.
Le retour de Trump à la tête des États-Unis menace-t-il le climat de la planète ? (Le Devoir)Le doctorant Tristan Muller et le professeur Laurent Bazinet, de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, signent un texte sur une recherche qui a permis de produire une farine très riche en protéines à base de lentilles d’eau. Les lentilles d’eau, des plantes aquatiques qui peuplent la surface des eaux douces un peu partout dans le monde, peuvent servir à faire des œufs en neige, des yogourts, de la mayonnaise, etc.
Une petite plante aquatique pourrait révolutionner l’alimentation de demain (L’actualité)Le réchauffement de la planète affecte de nombreux groupes de travailleurs et de travailleuses. Pour Pier-Luc Bilodeau, professeur à la Faculté des sciences sociales, ces perturbations parfois majeures forcent certains secteurs à se mobiliser pour faire face au défi climatique, notamment les conséquences des feux sur l’industrie forestière, mais aussi sur le travail des pompiers forestiers, de plus en plus souvent mobilisés pour y faire face.
La main-d’œuvre face au défi climatique (Unpoincinq)Marc-André Fortin, professeur à la Faculté des sciences et de génie, signe un texte d’opinion sur la rareté des étudiants québécois dans certaines filières stratégiques, dont les matériaux de haute technologie. Il y aborde la nécessité pour le corps enseignant de recruter des étudiants internationaux et de les franciser les étudiants.
Où sont la cohérence et la logique derrière notre gestion des étudiants internationaux ? (Le Devoir)Les mesures de conciliation famille-travail évoluent. Lise Chrétien, professeure à la Faculté des sciences de l’administration, considère qu’employer le terme « conciliation famille -travail » est réducteur. Selon elle, chaque individu incarne beaucoup de choses, il n’est pas que « famille » ou ‟travail ». Il est parent, ami, frère ou sœur, sportif, coach sportif, bénévole, membre d’un conseil d’administration, etc.
Vers un nouvel équilibre (La Presse)Le premier ministre Doug Ford demande au prochain président d’adopter une approche commerciale « Achetez Can-Am » qui crée de nouveaux emplois et des débouchés pour les travailleurs et les entreprises des deux côtés de la frontière. Louise Blais, experte en résidence à l’École supérieure d’études internationales, et Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration, aborde l’économie intégrée des deux parties.
Élections américaines : des expatriés en Ontario « préoccupés et stressés » (Radio-Canada)Au-delà de la confusion semée par l’annonce du quasi-gel de l’immigration permanente au Québec, des experts invitent à voir le sentiment de panique qui se répand chez les immigrants. Selon Danièle Bélanger, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, c’est difficile maintenant d’agir en toute cohérence avec le discours politique, alors que les pressions économiques et humanitaires s’exercent de tous côtés.
Le gel de l’immigration permanente, une « catastrophe », selon les experts (Le Devoir)Aux États-Unis, l’accès au vote est inégal d’un État à l’autre alors que certains placent des obstacles sur la route des électeurs pouvant les décourager. Anessa Kimball, professeure à la Faculté des sciences sociales, explique que l’idée est de laisser les États faire leurs affaires. C’est pourquoi on laisse tout ce pouvoir discrétionnaire au niveau de l’État. Chaque État gère ses élections, créant ainsi une disparité dans les façons de voter à la grandeur du pays.
Dur, dur de voter aux États-Unis (Radio-Canada)Le cerveau des patients atteints de lombalgie chronique (douleur au bas du dos) affiche une différence importante par rapport aux gens en santé : la région du cerveau qui contrôle les muscles de cette région du corps est plus petite. Selon Amira Cherif, chercheuse postdoctorale à la Faculté de médecine, il y a des circuits neuronaux altérés qu’on pourrait réhabiliter avec la neurostimulation magnétique, en combinaison avec des exercices ciblés.
Pour mieux combattre la douleur chronique (La Presse)Saviez-vous que le contenu de votre panier d’épicerie peut en dire beaucoup sur vos affiliations politiques ? C’est ce qu’a révélé l’équipe de Yannick Dufresne, professeur à la Faculté des sciences sociales, qui a fondé l’application Datagotchi. Elle vise à revoir la façon dont les sondages et les données sont analysés. L’application construit ses analyses sur l’aspect social du vote qui est souvent occulté par les consultations traditionnelles.
Votre panier d’épicerie en dit beaucoup sur vos allégeances politiques, selon cette application (TVA Nouvelles)La ministre des Transports a affirmé que son gouvernement est celui qui a le plus investi en transport collectif de tous les temps. Selon Jean Dubé, professeur à la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, le gouvernement Legault est celui qui a « prévu » le plus d’investissements en transport collectif dans l’histoire récente, pas (ou du moins pas encore) qu’il est celui qui a le plus dépensé.
Qui a « le plus investi » en transport collectif de l’histoire ? (Le Soleil)À un an du prochain scrutin municipal, le parti du maire de Québec a dévoilé une vidéo à saveur électorale dans laquelle il met l’accent sur la qualité de vie des familles. Selon Thierry Giasson, professeur à la Faculté des sciences sociales, la mise en avant du thème des familles est une bonne stratégie dans le contexte actuel, répondant sans doute aux enquêtes et données dont dispose l’équipe pour déterminer qui sont les électeurs qui hésitent.
Précampagne municipale : Bruno Marchand misera sur les familles (Journal de Québec)Avec le changement d’heure, Charles Morin, professeur à la Faculté des sciences sociales, donne quelques conseils pour mieux vivre ce passage. Il souligne que se lever à la même heure que d’habitude est important pour l’adaptation. Il faut aussi maintenir les heures des repas et le premier contact social du matin. Si on est sujet à la dépression saisonnière, la luminothérapie est tout indiquée.
Comment faire face au changement d’heure (La Presse)Pierre-Luc Brisson, professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines, décrypte un thème d’actualité à partir d’une comparaison avec un événement historique. Les républiques sont-elles mortelles ? C’est la question que posait l’historien Edward J. Watts sur la chute de la République romaine au Ier siècle avant notre ère. Le titre de cet ouvrage est révélateur du climat politique qui prévalait aux États-Unis.
Les Républiques sont-elles mortelles ? (Le Devoir)